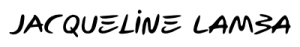Yves Bonnefoy et Jacqueline Lamba
« Je pense, écrivant ceci, à Jacqueline Lamba. » (Yves Bonnefoy)
« Je pense, écrivant ceci, à Jacqueline Lamba… » A l’occasion de la parution prochaine des Œuvres d’Yves Bonnefoy dans la Pléiade, nous redonnons ce texte écrit en 1967, à l’occasion d’une exposition consacrée aux peintures de Jacqueline Lamba à Antibes.

Sans titre. Circa 1955.
48cm x40,5cm. Huile sur toile.
J’ai lu que dans la langue de certains Indiens d’Amérique le mot montagne est un verbe. Et je m’interroge depuis sur cet accident du paysage verbal, qui ne m’apparaît que de loin, mobile dans ses contours comme une figure de rêve. Car telle est la contradiction qui le rend aussi fascinant qu’impossible : il faut que la montagne y soit indiquée, avec ses chemins et ses pierres ; mais alors comment concevoir que l’action qu’en tant que verbe il désigne soit simplement quelque « apparaître » ou « surgir » ? On peut penser, le sacré se manifestant sur les cimes, que celles-ci furent prises, avec leurs traits distinctifs, pour symbole de sa venue. S’étendre au loin, s’environner de nuées, laisser sourdre mille torrents, s’illuminer, retentir, le verbe montagne, ce serait alors tout cela… Moi, je préfère me persuader qu’une intention plus systématique a œuvré dans cette langue inusuelle ; et que ce fut, par fusion générale du substantif et du verbe, de contraindre l’esprit à l’expérience dans chaque « chose » de la venue du divin. Le verbe dans le nom ferait de l’objet une vie. Nos langues ont d’autres lois et ce projet n’y peut prendre forme. Mais est-il pour autant absurde ? L’art se cherche aux confins de nos moyens linguistiques, ayant l’incarnation pour destin, et peut le prendre à son compte.
Je pense, écrivant ceci, à Jacqueline Lamba.

Sans titre. 1980. 43cm x53,5cm.
Encre de chine sur papier calque.
Je pense, écrivant ceci, à Jacqueline Lamba. Que veut-elle, sinon identifier le verbe et substantif, autrement dit réinventer la montagne – depuis longtemps, comme pour Cézanne, son lieu – dans ce que celle-ci a d’enveloppant et d’actif : la plénitude qui peut saisir quand on s’en va dans les pierres ? Partout dans ce qu’elle peint cette irradiation des coteaux, ce magnétisme des pentes. J’aime en particulier ses réseaux de points, où semble se marquer le travail, dans le sol de la perception, dune aridité mystérieuse. Et il me semble qu’ils offrent, au problème du signe-vie, une sorte de solution. Ces nœuds, et ailleurs ces taches, ces mouvements de couleur, sont suffisamment espacés pour disloquer la continuité tout extérieure et passive que nous projetons sur les choses. Mais ils demeurent assez en sympathie réciproque, en convergence de forces, pour suggérer l’intériorité d’un lieu, l’unité de son existence sous la variété de ses plans et de ce fait nous voici en marche, engagés parmi des aspects qui se succèdent et se dénouent, passant à travers eux qui ne sont que la dépouille de l’être.
Jacqueline Lamba : quitter la vieille maison des apparences scellées – et se porter à une rencontre. Ses rapides études préliminaires, toujours si sûres sont un acte de délivrance, on y entend le cri de la terre rendue à soi. Et la preuve, c’est que le lieu nous est donné tout entier, malgré la brièveté des indications : c’est comme si la blancheur des pages, plus révélée que vaincue par le trait à l’encre de Chine, s’identifiait à ce que l’on ne peut voir quand on regarde un brin d’herbe, mais qui est là tout autour, et qui frémit et nous comble. Tout a vie, et nous d’abord, qui n’avons plus à nous épuiser, à maintenir l’ordre, à faire régner l’apparence, à contenir l’invisible qui ne demande qu’à sourdre.
Troubler les accents d’un blanc profond ses harmonies chaleureuses.
Mais pourquoi, s’il en est ainsi, Jacqueline Lamba élabore-t-elle si lentement ses tableaux, pourquoi n’est-elle jamais en paix avec des exigences qui sont en elle bien davantage que dans les escarpements de Simiane qu’elle n’a plus, d’ailleurs, à Paris dans son atelier ? Un premier regard sur sa peinture, et on sera peut-être surtout frappé par des accords de couleurs qui demeurent pures, par quelque chose d’abstrait ou de musical dans le jeu des taches, ou même par la calligraphie, au sommet de beaucoup de toiles, des éclatements de bleu sombre ou d’orangé dans le ciel. Jacqueline Lamba aime troubler les accents d’un blanc profond ses harmonies chaleureuses. Elle aime peindre sur de vieux journaux, dont la typographie remonte à travers la trame figurative et se met en rapport avec les formes et la couleur. Est-ce là concurrence entre la structure de l’œuvre et le questionnement de l’objet ?
Mais remarquons que les couleurs, par exemple, bien qu’intensifiées, quintessenciées, sont toujours celles même de la lavande ou du roc. Et si ces divers éléments si concrets dans leur origine, forment ensemble comme une gamme, de quoi se sert une certaine écriture, il ne faut pas penser que c’est quitter pour autant le lieu et le devenir de la rencontre première. Car celle-ci, c’est projeter ses sentiments dans les couleurs et les rythmes du paysage, ses valeurs dans ses formes, son bonheur ou son drame dans ses harmonies, ses tensions : et le laisser parler ne peut donc que conduire à la recherche de soi. Dans la langue qui n’est que verbe, il n’est de parole que personnelle. En décomposant le donné visuel, Jacqueline Lamba recompose le donné d’être ; et reviendra, par existence vécue, par approche lente de soi devant la toile ébauchée, à ce qu’annonçait le premier instant.
Danseurs parmi les herbes

Sans titre. 1956. 57cm x63,5cm.
Encre de chine sur papier.
Et c’est à cause sans doute de cette union du lieu évident et de la personne secrète, c’est dans cette atmosphère troublée, toujours un peu orageuse, de lieu-parole, que ces tableaux paraissent bouger, tapisseries dans le vent. L’image et l’objet « réel », l’intérieur et l’extérieur, qui se risquerait devant eux à prétendre les opposer ? Des images aussi y bougent, d’autres images, et j’y vois affleurer les danseurs d’une société archaïque, presque immobiles parmi les herbes, silencieux. Le tambour et le sistre résonnent dans le ravin. Un danseur est peint de jaune et de blanc, parce qu’il est la montagne, un autre est masqué de bleu, si bien que l’intervalle entre eux, la faille d’air qui vacille et s’anime de plus en plus, c’est le chemin ou la cime, – le « vrai » chemin là-bas étant devenu au même instant leur joie, leur souffrance, ou plutôt le dépassement de l’une ou de l’autre dans l’unité qui se fait.
« Sur la pente du talus les anges tournent dans leurs robes de laine dans les herbages d’acier et d’émeraude. » Rimbaud aussi, dans Les Illuminations, a tenté la synthèse du sujet et de l’objet, pratiqué la métaphore ouverte de toute part, la fidélité à l’intense. Et quand il vient à décrire une peinture, évoquant : « cette bande en haut du tableau » qui « est formée de la rumeur tournante et bondissante des conques de mer et des nuits humaines », ne dirait-on pas qu’il a sous les yeux, évidemment par éternité de la vision poétique, un des tableaux de Jacqueline Lamba ?
Yves Bonnefoy, Exposition Jacqueline Lamba au Musée Picasso (Antibes), 11 août-31 octobre 1967.